Outsider talentueux et tourmenté, célébré aujourd'hui à juste titre comme l'un des maîtres les plus raffinés du genre gothique, Leo Perutz, pour échapper aux angoissants goulots d'étranglement de la réalité, tourne son regard vers le vaste champ des souvenirs de l'Antiquité et tisse un dialogue très personnel avec l'ombre des grands du passé, seuls capables d'apaiser son solipsisme exacerbé.
di Paul Mathlouthi
Mathématicien marqué par une veine littéraire sophistiquée, baroque et imaginative, considéré comme un génie par Ian Fleming, aimé par Borges et idolâtré par Alexander Lernet Holenia, qui se reconnaissait avec déférence comme son débiteur et élève, Léo Perutz (1882 - 1957) a longtemps joui de mauvaise presse dans notre pays et ailleurs, en partie à cause de sa mauvaise humeur proverbiale qui ne lui a pas permis de gagner les sympathies volages et ombrageuses des critiques de la vie, mais surtout en vertu de la poursuite de ce préjugé tenace du XXe siècle qu'il voit chez les écrivains de contes fantastiques des champions obscurs et arriérés de la Réaction, comme on disait dans le petit siècle qu'on s'est empressé de mettre de côté. Jouer avec l'histoire, envisager des issues alternatives d'événements connus, laisser entrevoir d'autres cieux et d'autres terres, espérer des avenirs possibles a toujours été considéré comme une attitude suspecte par les zélés gardiens de l'orthodoxie culturelle, une forme rampante de dissidence d'autant plus dangereuse si, comme dans le cas de écrivain praguois, s'accompagne d'une attirance morbide envers les vaincus, c'est-à-dire ceux qui, au mépris de l'esprit du temps dans lequel le destin les a contraints à vivre, choisissent de prendre parti in partibus infidèle, ne dédaignant pas, quand les circonstances l'exigent, de se vouer à la damnation.
Une très forte odeur de soufre émane des pages de ses romans, mais si un critique assermenté tel que Ladislao Mittner a jugé nécessaire pour cela d'exclure Leo Perutz du canon d'or de Littérature de langue allemande, d'un avis tout à fait opposé (dont nous sommes immensément reconnaissants) était la lamentation Roberto Calaso qui, malgré le jugement méprisant de Bertolt Brecht, a republié ces dernières années quelques-unes des œuvres les plus significatives du talentueux et tourmenté outsider qui, sorti de l'oubli où l'avait relégué l'exégèse militante, est aujourd'hui célébré à juste titre comme l'un des plus grands maîtres de genre gothique. Pour échapper aux angoissants goulots d'étranglement de la réalité, l'écrivain, pessimiste colérique, tourne son regard vers le vaste champ des souvenirs de l'Antiquité et tisse un dialogue très personnel avec l'ombre des grands du passé, seuls capables d'apaiser son exacerbé solipsisme.
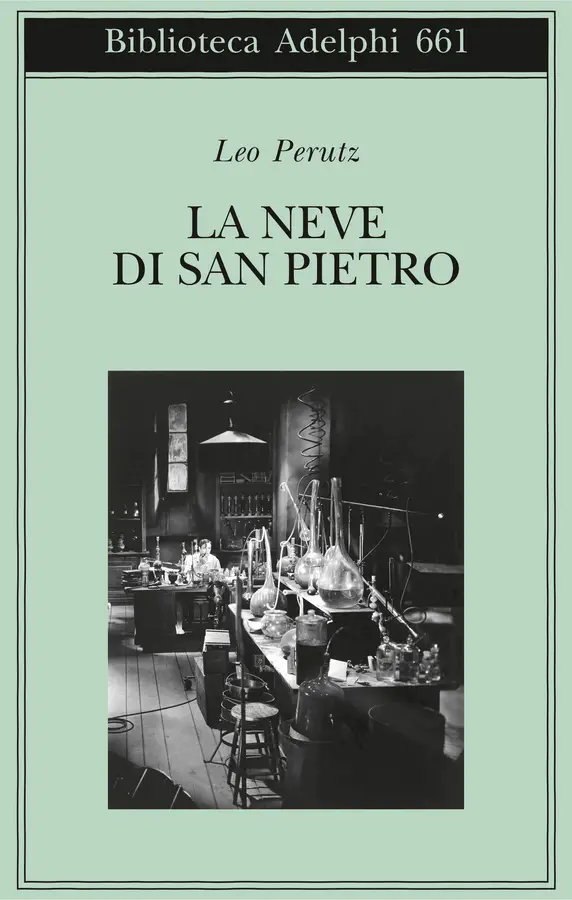
Voici ce qui arrive à l'anti-héros du roman La neige de San Pietro, le dernier dans l'ordre chronologique d'une anthologie recherchée de titres de l'énigmatique érudit bohème que la maison d'édition Adelphi a inclus dans son prestigieux catalogue. L'histoire s'ouvre dans la candeur aseptique d'une chambre d'hôpital où le protagoniste, Friedrich Amberg, reprend lentement connaissance. Aux infirmières qui l'assistent et lui racontent un grave accident de voiture dans lequel il a été impliqué, le patient répond qu'il a subi les blessures qu'il a sur le corps à la suite des coups reçus par un groupe de paysans en révolte qui l'aurait agressé lors d'une émeute. La curieuse nouvelle fait bientôt son chemin dans les couloirs et parvient aux oreilles du médecin-chef qui, incrédule, se rend au chevet du patient et l'invite à raconter son histoire. Avec peine à renouer les fils perdus de la mémoire, le jeune homme déclare s'être rendu à Morwende, un village reculé au cœur de la Westphalie, un lieu situé hors du temps et à peine lapé par la Modernité, à l'invitation de l'excentrique châtelain local. , le baron von Malchin, qu'elle avait engagé plus tôt comme médecin.
Le noble l'accueille d'abord avec une certaine froideur, dictée par la différence de rang, mais entre les deux une relation basée sur l'estime mutuelle s'établit chemin faisant. Un soir, invité à dîner au manoir, le médecin apprend par la voix de son hôte l'inquiétant projet qu'il a en tête de mettre en œuvre. Von Malchin se déclare un fervent partisan de la monarchie absolue de droit divin et ne cache pas le profond mépris qu'il porte à la démocratie libérale, coupable, selon lui, d'avoir déterminé la désenchantement du monde. Les gens ont perdu confiance en mission salvatrice des souverains parce que, grâce à la diffusion des doctrines progressistes, cette tension religieuse, ce ravissement mystique qui fut le fons juris sur laquelle se fonde la société dans le monde de la Tradition.
Continuer à tracer les contours de lautopie régressive auquel il croit avec une détermination de fer devant les yeux étonnés du docteur, le baron affirme que, sur la base de quelques études menées par lui, les principaux phénomènes de fanatisme religieux, du mouvement dolcinien aux révoltes hussites, se sont produits en l'Europe dans ces les zones rurales où le blé a été affecté par une toxine particulière aux pouvoirs hallucinogènes, connu dans les anciens herbiers sous le nom de "La neige de Saint-Pierre". Avec l'aide du Dr Kallisto Tanaris, surnommé "Bibiche", un biologiste fascinant qui avait été condisciple d'Amberg, von Malchin entend reproduire le substance semblable à une sorcière de l'administrer à ses fermiers, diluée dans de la bière, lors d'un somptueux banquet qu'il compte offrir aux habitants du quartier à l'occasion des célébrations de son anniversaire.

A ce moment-là, il leur aurait montré le descendant direct du dernier Hohenstaufen, un adolescent nommé Federico qu'il a adopté après l'avoir trouvé dans une ferme de la région de Bergame (sic!) Et eux, envahis par la fureur religieuse, auraient reconnu et l'acclama de nouveau, rétablissant ainsi l'autorité légitime. "Vous voyez la maison ?"- déclare le Baron en montrant à son ami la maison où repose sans le savoir le jeune héritier désigné -"C'est le Kyffhäuser, être l'Empereur secret vit dans l'attente. je lui ouvre la voie. Et un jour, je dirai au monde les mots criés par le serviteur sarrasin de Manfredi aux citoyens de Viterbe en révolte : « Ouvrez les portes ! Ouvrez les cœurs ! Regarde, ton seigneur, le fils de l'Empereur, est venu !"» .
Le dessein hallucinatoire de Von Malchin est en réalité réalisé, mais maintenant l'esprit du temps a irrémédiablement changé de direction. Faucilles et fusils sévissent dans la plaine, selon les prédictions du baron, mais cette Vendée postmoderne révèle bientôt, ironie du sort, une tout autre connotation idéologique que celle espérée par von Malchin : les paysans, marchant sous les drapeaux rouges au chant de l'Internationale, assiègent son château et, guidés par Bibiche elle-même transformée en Erinyes, prêtresse possédée de la nouvelle hérésie révolutionnaire, ils le livrent à l'étreinte purificatrice des flammes. Le rêve d'un retour dans le passé, appliqué à la lettre, a fini par virer au cauchemar entre les bobines duquel l'apprenti sorcier lui-même a trouvé la mort.
Dans ce roman, sorti à la veille de la prise du pouvoir par Hitler, Leo Perutz nous propose une réinterprétation du XXe siècle insolite, mais non moins sulfureuse et inquiétante, du mythe germanique de l'Empereur endormi qui, selon la légende, reviendra à la fin des temps pour racheter l'humanité et le monde, où le drame personnel du protagoniste - esclave d'une obsession et contraint de se mesurer à un Destin contre lequel rien n'est possible et qui s'amuse à jouer avec lui comme un chat avec une souris avant de porter le coup fatal - s'inscrit dans un cadre de reconstruction rigoureuse et rationnelle du contexte historique et social où, pourtant, soudain, l'Irrationnel jaillit comme un feu follet et, donnant corps et substance aux ombres générées par le sommeil de la Raison, il allume la mèche de l'Imagination, ouvrant sous les yeux du lecteur des scénarios inattendus et des chemins insolites aux résultats imprévisibles.
Celui de la prédestination et le inévitabilité est un thème récurrent dans les romans de l'écrivain bohème. Les situations et les éventualités changent, bien sûr, mais nous nous retrouvons à la cour du roi de France aux prises avec un complot de palais visant à assassiner le souverain, dans une Espagne picaresque et sanfédiste. envahie par les troupes napoléoniennes ou dans une Russie dévastée par les secousses de la Révolution d'Octobre, les choix des individus sont toujours hétéro-orientés par forces obscures et impénétrables, qui se disputent leurs âmes; Et le Diable, le grand protagoniste de ces polars métaphysiques, met volontiers la main à mélanger les cartes et à enchevêtrer les événements de manière inextricable, propice à l'improbable échanges en personne, comme cela arrive aux protagonistes de Le chevalier suédois, ou se cachant dans les pages d'un livre maudit, dont la possession implique la sonnerie d'une inquiétante série de crimes consommés dans les rues de Vienne des Habsbourg. Homme au solide bagage scientifique, Leo Perutz est pourtant irrésistiblement séduit par le surnaturel, surtout lorsqu'il se teinte des couleurs des ténèbres :
"La peur et le fantasme sont liés par un lien indissoluble, - affirme l'écrivain par la bouche d'un de ses personnages -" (…) celui qui a une imagination particulièrement fervente est en même temps obsédé par mille angoisses, mille terreurs (… ). Connaissez-vous la peur ? (…). Vous pensez vraiment la connaître ? (…). La vraie peur (...) qui submergea l'homme des cavernes lorsque, hors du cercle de lumière de son feu, il fit face à l'obscurité, tandis que les éclairs s'élançaient des nuages et que le cri des sauriens primordiaux résonnait des marécages, le primitif peur de la créature solitaire... aucun de nous contemporains ne peut prétendre la connaître, aucun de nous ne saurait la supporter. Et pourtant le capteur, qui est capable de l'éveiller en nous, n'est pas mort, voire vivant, quoique peut-être en proie à une matité millénaire : il ne donne ni signes ni signaux... notre cerveau porte en lui un monstre en hibernation "(2 ).
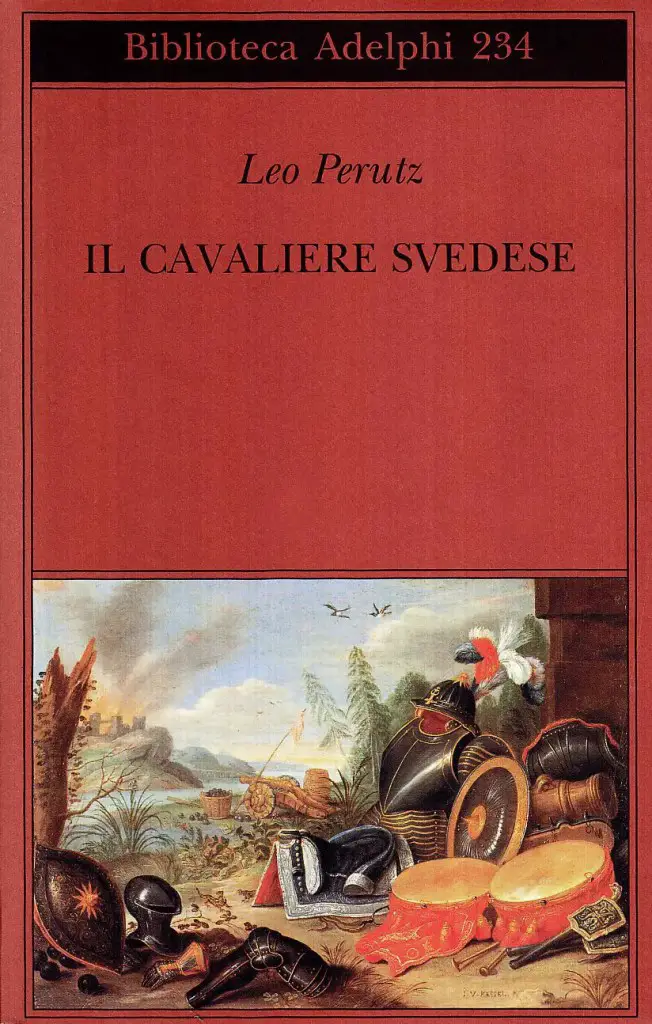
Une prise de conscience qui place naturellement Leo Perutz dans le lit d'une illustre tradition littéraire, celle du réalisme fantastique d'Europe centrale, aux côtés Gustave Meyrink, Max Brod, Alfred Kubin. Des écrivains très différents mais inconsciemment unis par le fait que leurs vies errantes ont touché et parfois croisé le long des rues de Prague.
Capitale de la magie et du savoir occulte, comme l'était Tolède au Moyen-Âge, cette ville splendide, où la rigueur allemande de l'architecture cohabite avec l'âme slave, fataliste et rêveuse, est élue demeure privilégiée par l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, qui en le seizième siècle a accordé l'asile à sa cour à Magiciens néo-platoniciens, astrologues, kabbalistes et philosophes ailleurs persécuté par la Sainte Inquisition. Le pont Karol, le quartier de Santa Maria della Neve, non loin de la Piazza Jungmannovo où, en 1415, Jan Hus a été brûlé sur le bûcher, précurseur de Luther qui, avec son oratoire véhément depuis la chaire de la chapelle de Bethléem, incite les frères bohèmes à la désobéissance civile et à la révolte contre la corruption du clergé d'observance espagnole, les Ghetto juif étayés dans la nuit par des pièces mal éclairées où des rabbins récitent, à la lueur tamisée des bougies, les formule pour réveiller le Golem, monstre d'argile appelé à se venger de ceux qui persécutent les enfants dispersés d'Israël, les pavés des rues de Mala Strana qui conservent encore l'écho des pas de Corneille Agrippa et Paracelse, serpentant à travers les nombreuses demeures historiques aux armoiries nobles indéchiffrables qui se disputent l'honneur et la charge d'avoir accueilli nul autre que le Docteur Faustus, un personnage qui a réellement existé, semble-t-il, médecin et enquêteur de l'occultisme, qui aurait alimenté l'imaginaire de Goethe et Thomas Mann: tout ici renvoie à un passé lointain et à des cultes ancestraux oubliés.
Ville utilisée pour courtiser la mort, Prague, pleine de fantasmagories dans laquelle des essaims de fantômes errent sans être dérangés au crépuscule, surgissant à chaque intersection pour piéger les passants sans méfiance, comme cela se produit dans l'église de San Giovanni al Lavatoio, où l'on dit qu'au coup de minuit, il apparaît un moine en noir conduisant un char infernal tiré par deux boucs monstrueux aux yeux flamboyants, forcé d'errer sans relâche pour avoir offert à Dieu une fausse pièce de monnaie. Ames en peine de scélérats condamnés au gibet, chevaliers acefalmoi, des cadavres avec des poignards dans la poitrine de femmes nobles hautaines coupables d'infanticides odieux se réunissent sous les murs du château de Hradcany comme à un sabbat. Une scène majestueuse suspendue entre ciel et terre sur laquelle, comme dans une représentation allégorique, se pressent une foule bigarrée de personnages, héros et scélérats, philosophes et imposteurs, saints, hérétiques et possédés, chacun occupé à jouer un rôle préétabli sous le regard rêveur de l'Empereur qui de ce caravansérail ardent disputé entre le Ciel et l'Enfer est le véritable comédien, le marionnettiste suprême, il fut le premier archétype vivant, à la fois grand prêtre et sacrificiel victime de la Liturgie luciférienne de Prague.

Dans le recueil de nouvelles intitulé "La nuit sous le pont de pierre" Leo Perutz le décrit barricadé dans les pièces les plus isolées de sa maison, indifférent aux affaires de l'État, sourd au rugissement rugueux du monde qui bouillonne furieusement comme la mer orageuse juste au-delà des remparts, avec la Flandre déchirée par la sanglante guerre fratricide qui oppose les catholiques aux protestants alors que de larges portions de la Hongrie gisent sous le joug turc, soucieux uniquement de remplir de merveilles la wunderkammer qu'il a fait installer dans les somptueuses salles suspendues au-dessus du Deer Moat. Jacopo Strada, antiquaire de cour très puissant et omniprésent, a pour mission de récupérer les objets les plus étranges du monde entier et de satisfaire à tout prix l'envie frénétique de collectionneur du souverain.
Élevé à l'Escorial, sous le fouet de la discipline rigide de la Contre-Réforme imposée par son oncle Philippe II d'Espagne qui voulait en faire un champion de la foi, Rodolfo développa dans sa jeunesse une haine sourde envers les jésuites, coupables en ses yeux de comploter pour le saper du trône et ainsi favoriser (comme cela arrivera en effet) le frère plus résolu Mattia. Sa haine qui, dans une sorte de mécanisme pervers de compensation, grandit avec le temps en même temps qu'une véritable fixation pour l'occulte. Obsédé par l'idée de prédestination liée à la haute fonction de dignité impériale à laquelle il a été appelé par le destin, il questionne la automates mécaniques fantaisistes dont il s'entoure comme s'ils étaient ses conseillers, il scrute les bizarreries de la préciosité qui peuplent son bazar privé pour tenter d'apercevoir les présages, les signes, les prémonitions de l'avenir.
Superstitieux, traqué par les affres de la solitude, l'Empereur devient facilement la proie de ceux qui, par de douces flatteries, savent subtilement manipuler sa nature saturnienne à son avantage, comme Mordecai Meisl, figure sinistre et oblique d'usurier qui lui prête l'argent nécessaire pour cultiver ses obsessions farfelues, d'abord étude de l'alchimie. Pour séduire le cœur assombri de l'Empereur, c'est l'inquiétude fébrile ressentie à l'idée de pouvoir changer à volonté le cours des événements, l'émotion vertigineuse exquisément Renaissance procurée par l'espoir de voir l'homme triompher, par l'art compliqué de transmutation des métaux, sur les lois immuables établies par Dieu, même au prix de vendre l'âme au Diable. Un défi prométhéen qui le fascine, le tire du sommeil, le séduit et le maintient en vie, mais lui attire aussi les inimitiés dangereuses de nombreux membres influents de sa entourage.
Le nonce apostolique Filippo Spinelli écrit d'un ton alarmé au pape Paul V Borghese en disant qu'il est sûr que Satan a insinué son pied de chèvre dans les chambres secrètes de Hradcany et l'exhorte à intervenir le plus tôt possible et d'une main ferme pour ramener l'Empire sous le signe de la véritable alliance. Le pape confia alors au chancelier Philipp Lang von Langenfels, chef du "parti" catholique à la cour, la tâche d'engager secrètement des négociations avec l'archiduc Matthias pour sonder son éventuelle volonté d'évincer son frère. Il ne se laisse pas répéter deux fois : à l'insu de l'Empereur, engagé dans les travaux de la Diète de Ratisbonne, il réunit les nobles magyars qui l'acclament roi de Hongrie et mettent leurs armes à sa disposition pour qu'il marche sur Prague et réclamer avec la force qu'elle mérite.
Enfermé sous l'emprise du siège, abandonné par ses plus proches collaborateurs qui, pour sauver sa peau, font acte de soumission envers l'usurpateur, Rodolfo ne peut que renoncer au trône et à la couronne. Relégué dans une aile inaccessible du palais impérial, surveillé par les gardes de son propre entourage, il passera les jours qui lui restent à vivre prisonnier dans sa propre maison, en proie à cauchemars et hallucinations récurrents. Le départ du monarque dément marque une exacerbation progressive du conflit religieux en cours. Le néoplatonisme humaniste et les mouvements hermétiques - kabbalistiques, laissés orphelins de la protection augustéenne, perdent leur bataille culturelle, entre accusations et accusations de possession, avec pour conséquence des procès et des condamnations inévitables.
Dispute entre catholiques et protestants, maîtres incontestés de la scène, l'Europe s'achemine par étapes forcées vers le bain de sang de Guerre de Trente Ans. L'abdication de Rodolphe II représente aussi le premier coup décisif porté à une certaine idée traditionnelle de la royauté, empruntée au Moyen Âge, qui voit dans la figure de l'Empereur une sorte d'hypostase métaphysique intangible dotée de deux natures, la première humain, sujet donc à la consomption induite par la vieillesse, mais le second est incorruptible et éternel, qui dans une succession quasi infinie transmigre d'un souverain à l'autre, l'essence dans laquelle réside l'âme elle-même, le chrême de l'autorité impériale. Une conception dépassée du pouvoir qui ne s'accorde pas avec le profil lugubre du potence levée dans les rues de Prague par les Suédois qui, entrés dans la ville dans la nuit du 26 juillet 1648, ravagent sans discernement les collections d'art auxquelles l'Empereur a consacré sa vie. La modernité a commencé sa douloureuse gestation aux dépens du monde antique mourant : d'ici aux guillotines le pas sera bien court.

Remarque:
- Léo Perutz, La neige de San Pietro, Adelphi, Milan 2016; page 96
- Léo Perutz, Le Maître du Jugement dernier, Adelphi, Milan 2012; page 185 - 186
