Le 11 avril 1989, il y a 32 ans, nous quittait l'écrivain anglais John William Wall, plus connu sous le pseudonyme de Sarban, l'un des rares écrivains voyageurs de notre époque. Récapitulons deux de ses ouvrages qu'Adelphi a publiés en italien ces dernières années : la nouvelle « Zubrowka. Un conte de Noël » et le roman « L'appel du cor ».
di Paul Mathlouthi
Couverture : Pieter Bruegel
Lo écrivain itinérant, c'est-à-dire celui qui utilise le voyage comme point de départ pour démêler la chaîne et la trame de son récit très personnel dans l'espace et le temps sur les événements tourbillonnants de ce monde vaste et étrange qui est le nôtre, est imprégné, je dirais presque possédé , par une fièvre aérienne du vent, une propension ancestrale à l'agitation à laquelle il est impossible de ne pas se livrer. Dès qu'il croit avoir pris racine, qu'il a trouvé un refuge sûr pour entreposer les restes de ses naufrages, l'envie de reprendre le voyage lui serre aussitôt le cœur et le presse, inexorable. Chaque retour apporte en cadeau les graines d'où germe éternellement un nouveau voyage, l'occasion d'un autre commencement.
Qui n'a pas goûté à cette sensation d'instabilité mercurielle, accro au désespoir tranquille dont il parle Thoreau dans lequel la plupart d'entre nous pataugent chaque jour, ne peuvent pas comprendre. Celui de pèlerin racontant est une typologie humaine et littéraire aujourd'hui proche de l'extinction : l'avènement de la Technique, à la fois fétiche et damnation de la Modernité, a contracté les temps et les espaces, transformant le trajet en simple distance entre deux lieux à consommer au plus vite, un événement anonyme , désormais totalement dépourvue de cette dimension initiatique qui, Homère a Tolkien, a nourri l'imaginaire protéiforme d'une lignée de géants à suggestions.
Certes, certains solitaires aiment Sylvain Tesson, Paolo Rumiz ou Simon Winchester qui dans leur prose errante conservent encore fièrement intacte la saveur archaïque, obsolète du va-et-vient. Il s'agit pourtant d'un choix esthétique, d'une posture courageuse mais résiliente, donc forcément dépassée, contraire à l'air du temps qui va par étapes forcées en sens inverse. Très différents par leur style, leur sensibilité et leurs coordonnées culturelles de référence, ils sont, peut-être malgré eux, unis par le fait qu'ils sont les enfants épars d'une saison irrémédiablement perdue, celle des grandes explorations. Une épopée commencée il y a cinq siècles, en une époque d'aventuriers, de vagabonds, de nostalgiques déracinés qui a connu son épicedium glorieux au XXe siècle.
Un caravansérail haut en couleurs celui des pionniers d'Ailleurs, une cour des miracles dans laquelle des personnages picaresques dignes de Lazarillo de Tormes, convaincus qu'ils peuvent obtenir une rédemption personnelle de vies constellées d'échecs par des entreprises désespérées dans des terres hostiles et inconnues qui les ont finalement engloutis , coexistent aux côtés de divinités tutélaires du calibre de Paul Morand, Patrick Leigh Fermor, Eric Ambler et Henry de Monfreid (pour ne citer que les plus connus), rejetons de la bonne bourgeoisie ou de l'aristocratie déclinante qui entrevoient dans le parcours un substitut à l'action, le dernier sauf-conduit accordé pour échapper à l'ennui de la normalité et exorciser les lancinants qui, d'incurables narcissiques tels comme sans qu'ils soient douteux, il les consume : l'anonymat, la peur d'être contraint de quitter le monde sans avoir fait de différence, de se tailler une cicatrice sur la terre, comme aurait dit Malraux.

Je suis précisément l'amour de la distance, l'attirance irrésistible pour tout ce qui échappe à l'ordinaire, l'envie spasmodique de savourer le vertige de l'immensité pour diriger Jean-Guillaume Mur (1910 - 1989) vers une carrière diplomatique, profession encore entourée, au début du siècle dernier, d'une aura de légende aventureuse, qui découle de la splendeur héroïque de Kipling et du Grand Jeu. Durant les années passées à Cambridge, le jeune et prometteur étudiant révèle une oreille particulièrement formée aux sonorités cryptiques des langues sémitiques, ainsi, lorsqu'en 1933, bien que très jeune, il devient fonctionnaire du Foreign Office, il est placé dans les rangs du département arabe, le même dans le qui, il y a quelque temps, servait Thomas Edouard Lawrence et, après une première mission à Beyrouth, il est affecté au bureau consulaire de Djeddah, en Arabie Saoudite.
D'autres destinations plus prestigieuses suivront vers cette destination lointaine au cours d'une vie mouvementée passée au service de la Couronne, mais la rencontre avec le désert, qui à perte de vue s'étend dans toutes les directions juste au-delà des murs de la ville jusqu'à ce qu'il touche l'horizon, a l'effet d'un coup de foudre sur le futur écrivain : la magnificence rapace de la mer de sable sans fin dans laquelle, comme récite le Coran, la rame ne coule pas, le silence assourdissant et impénétrable qui l'entoure, les cieux sans bornes qui la surplombent, sont gravés à jamais dans sa mémoire. La conscience tourmentante d'appartenir en quelque sorte à cette solitude désolée mûrit en lui : il se choisit le pseudonyme de Sarban, qui en Parsi signifie caravane, pèlerin.
L'histoire se déroule parmi les sables brûlants de cet avant-poste situé au bord du Rien Zubrowka, dont Adelphi a récemment proposé la première traduction italienne dans la nouvelle série "Microgrammi", qui ouvre son premier recueil d'écrits, Sonneries et autres contes curieux, paru en 1951 chez l'éditeur Peter Davies, fils adoptif (et malheureux) de James M. Barrie, auteur légendaire de "Peter Pan" qui, saisissant la trame d'un grand conteur qui se cache derrière la nature timide et tapageuse du diplomate, il se livrera à ses crises de colère et à ses saturniens fantasques avec une patience laborieuse, souvent au détriment de ses propres poches ! Le lecteur, cependant, ne doit pas être trompé par les atmosphères ensoleillées et solaires qui, dans ce Divertissement ils encadrent la narration. Si, comme je l'espère, il aura la volonté de me suivre, s'aventurant dans le labyrinthe tortueux de ses contes de fées cruels, il découvrira avec surprise que Sarban ne cède rien au goût de l'exotisme propre à la littérature d'outre-mer. Au contraire, sa prose est ténébreuse, souterraine, tellurique, fantomatique, innervée par une sinistre veine créatrice irrésistiblement séduite par l'obscurité qui s'abreuve avidement à la source d'une obscurité magmatique et bouillonnante.
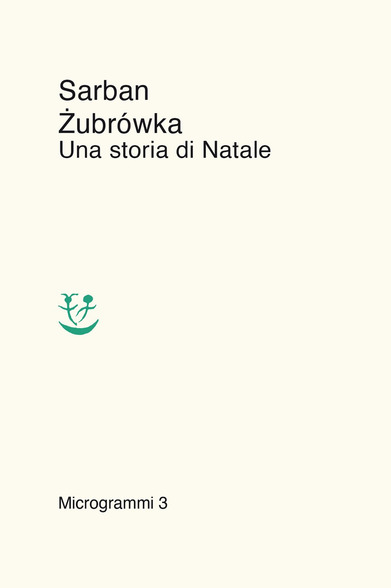
Niché au creux d'une nuit saharienne chaude et humide, Aleksandr Andreevic Masseev, ancien officier tsariste réfugié en Arabie avec sa femme Lidija sous la protection bienveillante de Sa Majesté britannique pour échapper à la fureur iconoclaste de la Révolution, se laisse aller au flot des souvenirs et se confie à 'Auteur, qui se prête volontiers au rôle de confesseur et de narrateur, des confidences sur un épisode effrayant qui lui est arrivé pendant la guerre. Les généreuses doses de vodka aux herbes que les deux convives avalent malgré le climat suffocant ont sur le protagoniste l'effet d'un madeleine: son esprit monte des rues sablonneuses du casbah planant sous d'autres latitudes et le ramenant dans le temps jusqu'à ce jour lointain de 1917 où, lors d'un vol de reconnaissance le long des côtes de Sibérie, suite à une panne moteur de son hydravion, il est contraint de faire un atterrissage forcé dans la taïga couverte depuis un épaisse couche de neige. Dans une tentative, bientôt vaine, d'atteindre la station météorologique de Kamennaja Gora à l'aide d'une boussole d'assistance, Alksandr et le copilote Igor Paljaskin sont engloutis par la tempête. Soudain, ils se retrouvent perdus dans un paysage extraterrestre, au profil lunaire, apparemment déserté de toute forme d'humanité :
Nous pourrions voir - rapporte le soldat russe dans son monologue halluciné - au loin l'immense et triste taïga, cette terre désertique plate et solitaire où chaque infime particule de vie était immobilisée dans la terrible poigne du Seigneur de la Glace, tandis que son corps sans vie continuait d'être poignardé par les baïonnettes du vent arctique. Et quand cela s'est arrêté on a su qu'un drap funéraire descendrait du ciel noir (…), le brouillard était un fantôme qui flottait à califourchon sur le vent, cachant ça et là ce monde inanimé avec son voile. Il n'y avait ni ténèbres ni lumière, mais un mélange indiscernable entre les deux, comme si la nuit qui approchait n'était que cette poudre de glace que maintenant l'orage soufflait sur nous (…). Nous pouvions atteindre la fin du monde avec notre regard, car il n'y avait rien dans le monde que cette lumière qui n'était plus lumière, cette terre incolore semblable aux cheveux d'un cadavre. (1)
Une désolation immaculée dans laquelle les chasseurs samoyèdes semblent être les seuls capables de défier l'inconnu et d'arracher des lambeaux de vie aux intempéries d'un hiver sans fin. Glissant énigmatiques et silencieux sur l'immensité de la neige avec la légèreté feutrée des renards, dont ils ont appris à imiter les pas, ces peaux couvertes de peaux, rescapées d'époques oubliées, se révèlent soudain émergeant de l'œil du cyclone en présence de deux malheureux étourdis, leur offrant aide et abri. Le feu devant lequel ils trouvent un rafraîchissement ne suffit pas à dissiper les peurs ancestrales qui s'emparent d'eux dans l'abîme des ténèbres arctiques sans fin, au contraire il les amplifie à outrance :
on entendait presque la sève ramper le long des petits sapins jusqu'au sol - dit Alexandre - et nous savions que cette nuit-là, le Seigneur de Glace viendrait nous rendre visite dans la taïga, lierait la rivière, briserait les branches des arbres et nous congelerait en pierres. (2)
Le lendemain matin, alors que la petite escouade reprend sa marche en file indienne vers la destination souhaitée, le démon invoqué dans l'obscurité se manifeste sous la forme d'une bête cyclopéenne dont les voyageurs ne peuvent deviner avec précision les traits qui se dirigent résolument vers eux :
le bruit que nous entendîmes peu de temps après nous glaça le sang. Dans l'horrible silence de la mort, nous avons entendu quelque chose approcher dans ce désert sans issue (…). Quel animal pourrait jamais incarner une telle force, une aussi formidable obstination ? Un être si majestueux et puissant qu'aucun Dieu n'avait jamais créé le même se traîna dans le marais. (3)
Un instant avant d'être atteint, une entaille providentielle s'ouvre dans la couverture de glace entraînant le monstre dans les profondeurs souterraines insondables qui se débat en vain pour échapper à la mort. Une hallucination ? Un mirage dû aux conditions climatiques prohibitives ? On ne le saura jamais, même si, prenant congé, Aleksandre avoue, fixant son interlocuteur dans les yeux, l'avoir aperçu un instant.
Ce qui est certain, c'est que dans les histoires de Sarban La nature ne connaît pas de dimension bucolique et n'offre aucun abri rassurant dans ses bras. Au contraire, c'est une présence imminente, panique, insinuant, hostile, doté d'une volonté autonome perverse. Divinité débridée et sauvage, sourde aux tribulations des hommes, plus marâtre que mère, affamée réclame des tributs de sang, réveillant en eux des instincts endormis et les forçant à un combat acharné pour sauver leur vie. Une leçon qu'Alan Querdilion, protagoniste du roman L'appel du cor, apprenez au détriment de votre propre santé mentale.

Lieutenant de la Royal Navy en 1941 embarque pour aller combattre les Allemands en mer Egée mais son navire est torpillé au large de l'île de Crète et lui, fait prisonnier, finit interné dans un camp de concentration d'Europe de l'Est d'où il parvient cependant heureusement à s'échapper, cherchant refuge dans l'épaisseur de la brousse contre ses geôliers qui, avec la méticulosité teutonique, tamisent la région centimètre par centimètre, suivant ses traces. Epuisé physiquement par les longs mois de détention et les privations subies, il se traîne des jours durant parmi les arbres qui semblent se resserrer autour de lui. Arrivé dans une clairière, il est frappé par une lumière éblouissante et tombe au sol inconscient. Au réveil, il se retrouve plongé dans la candeur aseptique d'une chambre d'hôpital où les infirmières, occupées et distraites, prêtent peu d'attention aux quelques phrases décousues qu'il prononce dans les rares moments de lucidité accordés par les sédatifs. Pendant les heures interminables de la nuit, le silence feutré des couloirs est interrompu par le son inquiétant d'un cor de chasse s'élevant de la forêt complexe située à la lisière de la clinique :
Le klaxon semblait errer dans les bois, les battant d'avant en arrière, appelant comme s'il cherchait quelque chose, parfois avec une férocité pressante, parfois avec une note longue et retenue de défaite. La nuit était pleine de bruits, la forêt aussi insomniaque que l'océan. Le vent secouait les hêtres devant la fenêtre, les arbres parlaient en une multitude de langues ; tout l'orchestre des bois jouait et le cor dirigeait. Il me semblait entendre toutes sortes de voix et d'instruments dans cette conversation sauvage, mon imagination pouvait transformer le gémissement des branches se balançant en le jappement des chiens de chasse, et le bruissement soudain et fort des feuilles frissonnant dans le vent en le crépitement de leur race. . Je suis resté longtemps là, à écouter, (…) et j'ai senti une agitation étrange monter en moi ; ce n'était plus de la tristesse que je ressentais, mais un état d'angoisse et d'appréhension, ce sentiment débilitant du danger qu'on éprouve parfois avant de comprendre de quel côté et de quelle arme on est menacé. (4)
Un trouble qui se confirme dans les révélations glaçantes du primaire Wolf von Eichbrunn, qui, en présence de son patient étonné, déclare, lorsqu'il est assez fort pour pouvoir se tenir debout, que l'Allemagne a gagné la guerre et cent ans depuis ce jour fatidique ! Après un premier étourdissement compréhensible, Alan en déduit qu'il a été catapulté par la mystérieuse luminescence qui l'a frappé lors de l'évasion de l'Oflag XXIX Z en une réalité alternative à la sienne, un univers parallèle où les SS dominent le monde sans partage. A propos de l'origine de l'écho funèbre qui résonne à travers la couverture des arbres la nuit, l'officier britannique apprend des divagations du médecin que c'est le son du cor avec lequel le comte Johann Hans von Hecklenberg, grand maître de la forêt du Reich, il appelle ses illustres invités à chiner dans l'immense domaine qu'il possède, dont la clinique fait également partie intégrante : un carrousel de chasse diabolique dans lequel les prisonniers des pays subjugués, transformés en grotesques hybrides zoomorphes, servent de gibier...
Quarante ans après la première édition italienne, publiée en 1974 par l'éditeur Valentino De Carlo sous le titre trompeur de Haute chasse, Roberto Calasso a re-proposé ce qui est aujourd'hui considéré comme une sorte de livre d'initiés parmi les amateurs de littérature d'horreur. Petit chef d'oeuvre destiné à inaugurer une tendance, le dystopie cruciforme, extrêmement prolifique. Comparé à certains adeptes célèbres tels que Fatherland de Robert Harris, Complot contre l'Amérique par Philip Roth La croix gammée sur le soleil par Philippe Dick, où la pertinence par rapport aux références historiques qui dessinent le contexte des événements racontés obéit à un principe de vraisemblance sinon de réalité, quoique savamment altéré dans le respect des règles qui jalonnent les mécanismes narratifs de l'ucronia, dans les pages de Sarban on peut respirer un air d'intemporalité raréfiée, comme si le drame se consommait en dehors des goulots d'étranglement imposés par la contingence du devenir.

En effet, l'auteur semble s'adresser un regard sur la dimension archétypale, sur les implications symboliques et oniriques de l'intrigue, qui sont pour le lecteur des clés d'accès aux territoires inexplorés de l'Invisible. Lorsque le protagoniste, qui à son tour deviendra la proie du maure sauvage, est amené devant von Hacklenberg, une scène se présente devant lui qui pourrait très bien trouver sa place dans un tableau de Pieter Bruegel ou d'Alfred Kubin :
l'homme qui était assis là, dominant la table et toute cette vaste salle, avait dans les yeux quelque chose de barbare que je n'avais jamais vu et qui dépassait de loin mes rêveries. Elle n'appartenait ni à mon siècle ni à celui du médecin ; et il était plus éloigné de ces politiciens nazis vulgaires et bruyants qui l'entouraient qu'ils ne l'étaient de moi. Leur brutalité était celle d'une civilisation de masse, urbaine et mécanisée, la cruauté sordide d'une tyrannie de haut-parleurs et de mitrailleuses. Hans von Hacklenberg appartenait à une époque où la violence et la cruauté faisaient partie de la personne, où le droit d'un homme de commander résidait dans sa force physique ; une telle férocité intime appartenait au temps des Uri, les taureaux sauvages de cette ancienne et sombre forêt germanique que la Cité n'avait jamais réussi à apprivoiser. (5)
Avec tout le respect que je dois à ceux qui, souvent de mauvaise foi, croient que le XXe siècle est un cimetière jonché d'épaves inutiles et d'idées mortes, il est indéniable que les grands totalitarismes du Siècle Court ont été une source d'inspiration inépuisable pour les écrivains qui ont investigué les différents aspects du Fantastique. Alors que les utopistes négatifs ont grandi dans l'ombre du Moloch soviétique comme Yevgeny Zamyatin et Stanislas Lem qui, animée par une conception de facto histoire progressiste et substantiellement confiants dans les possibilités de palingénésie inhérentes à la nature humaine, ils donnent corps et substance à leurs obsessions en les projetant dans des sociétés futuristes et hyper-technologiques habituées à explorer des espaces sidéraux, selon les diktats esthétiques de théories cosmiques en vogue au-delà du rideau de fer (6), Sarban, étant dans son cœur un pessimiste radical à qui le présent est tendu et n'attend rien de l'avenir, pour nourrir ses cauchemars qu'il puise au puits d'un passé sans mémoire, remonte à les racines du mythe. Alan Querdilion assiste, dans le double rôle de spectateur et de victime sacrificielle, à un rite cannibale ancestral au cours duquel les hiérarques offrent des libations humaines au démon qui, assis sur un trône de chêne au cœur impénétrable de son temple arboricole, propitie l'invincibilité du Reich. Un sombre Genius loci qui, soit dit en passant, porte le nom d'une des nombreuses personnifications de Odin en chasseur furieux (7).
Remarque:
[1] Sarban, Zubrowka. Une histoire de Noël, Adelphi, Milan, 2020; page 39 - 40
[2] Idem ; page 32
[3] Idem ; page 46
[4] Sarban, L'appel du cor, Adelphi, Milan 2015; page 54
[5] Idem ; page 103
[6] Courant de pensée né en Russie à la fin du XIXe siècle sur la vague du succès remporté par les écrits de Nikolai Fedorov, le cosmisme était une philosophie de la réalisation de soi qui, réconciliant les instances les plus futuristes de la science se rapportant à exemple de la manipulation génétique du vivant avec certains aspects du spiritisme orthodoxe, il espérait la régénération de l'humanité qui, libérée des affres de la mort, coloniserait plus tard l'Univers. Curieuse synthèse entre le scientisme positiviste et le traditionalisme russe, objet d'un intérêt particulier pour le pouvoir soviétique notamment pendant la période de l'exploration spatiale, comptait dans ses rangs certains des maîtres les plus reconnus de la science-fiction russe, comme Aleksandr Bogdanov. Sur le sujet, voir George M. Young, Les cosmistes russes, Tre Editori, Rome, 2017.
[7] Une ancienne légende westphalienne raconte l'histoire d'un comte Hans von Hacklenberg contraint d'errer éternellement à la tête d'une armée d'âmes agitées pour avoir maudit Dieu peu de temps avant de mourir d'une grave blessure que lui a infligée un sanglier lors d'une partie de chasse. Sur son identification avec Odin voir Giorgio de Santillana - Hertha von Dechend, Le Moulin du Hameau, Adelphi, Milan, 1983; page 287
